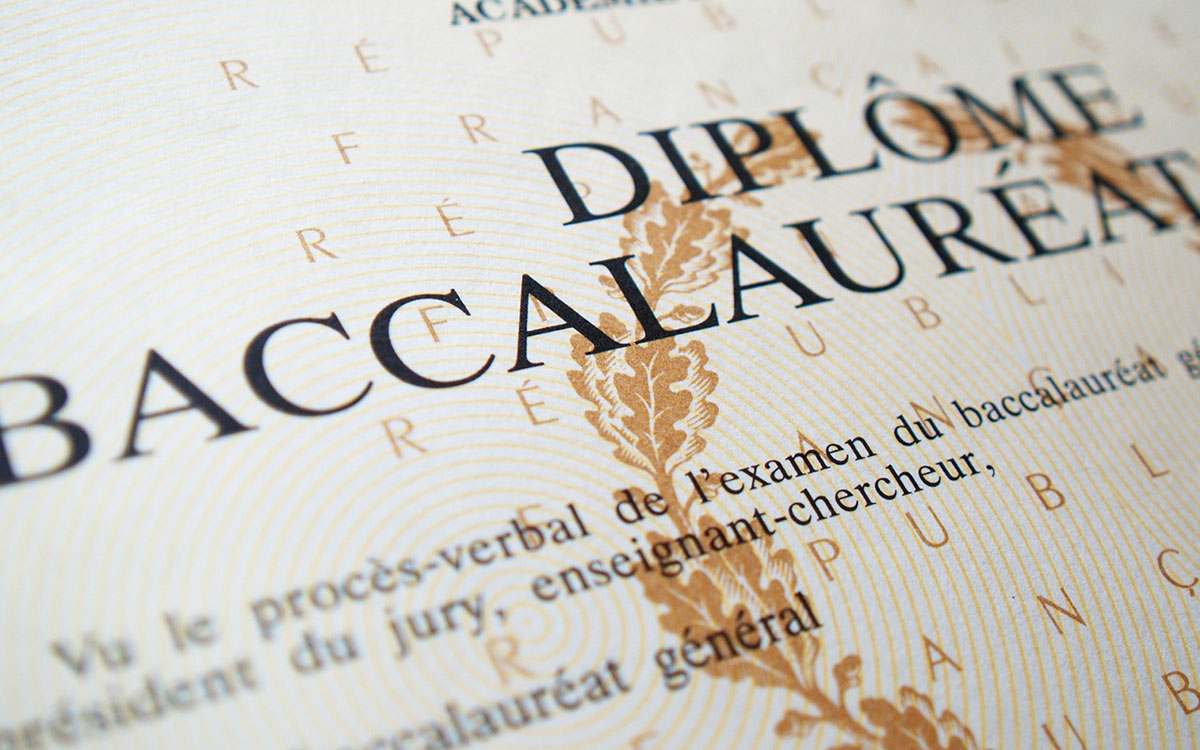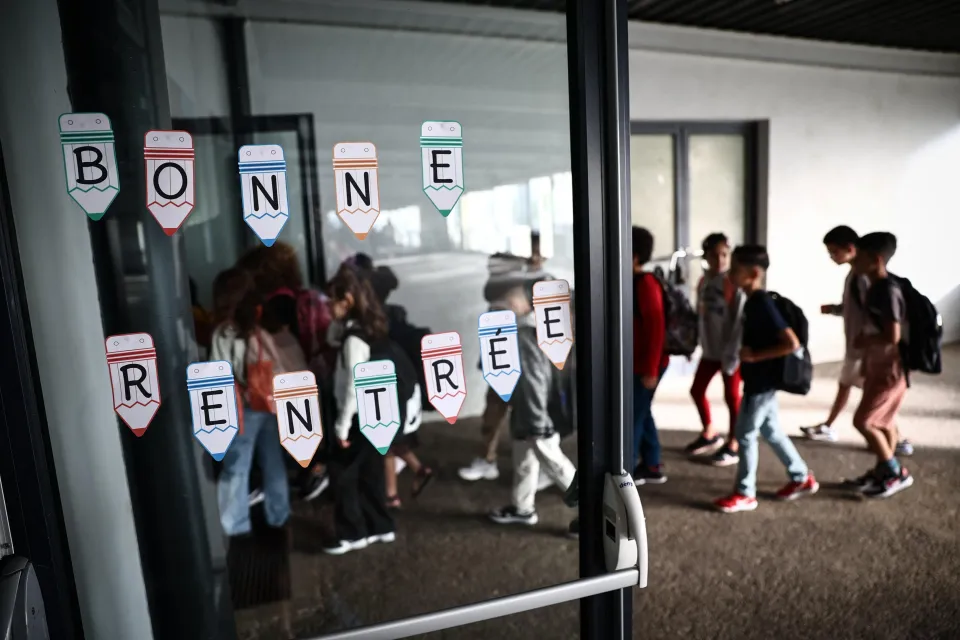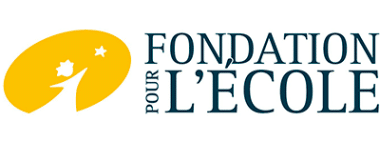Futurs directeurs d’école libre hors contrat
Conscients du défi que représente la direction d’un établissement scolaire, l’Institut de formation de la Fondation pour l’école et Alte Academia se sont associés pour proposer un parcours de formation en huit jours. Conçu pour réfléchir aux principes qui sous-tendent…
Lire la suite