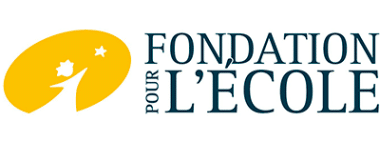Catherine Lucquiaud, docteur en informatique et en charge des questions numériques au sein de la Fondation pour l’école, propose une analyse de l’école numérique sous l’angle “économique,” en interrogeant les enjeux de marché et les tendances lourdes à craindre révélées par le confinement.
Après une trop longue période de déni, plus personne ne conteste donc aujourd’hui le pitoyable état de notre service public d’éducation. Trente ans de réformes successives largement controversées, qu’elles émanent de gouvernements de droite ou de gauche, ont abouti en 2020 à un système éducatif que les études officielles internationales dénoncent à la fois comme inefficace et comme accroissant toujours les inégalités sociales au lieu de les compenser.
Malgré des efforts consentis pour certaines classes de primaire qui ont vu leurs effectifs être réduits, l’état de l’institution scolaire en France ne satisfait encore ni les parents, de plus en plus inquiets pour l’avenir de leurs enfants, ni les enseignants qui ont le sentiment de n’avoir plus aucune prise sur un métier que l’immense majorité avait pourtant choisi par vocation sincère. L’engagement solide de nombre d’entre eux, voire l’abnégation pour certains, permet encore à l’édifice de tenir, mais dans quelles conditions, et pour combien de temps ?
Dans un tel contexte, que le ministère de l’Education nationale connaît à travers notamment les difficultés à recruter de nouveaux professeurs, le confinement inédit dans lequel nous a plongé l’épidémie de Covid-19 aurait été l’occasion de redonner enfin une véritable initiative aux éducateurs de terrain que sont les professeurs et les parents d’élèves et ce faisant, de conférer une substance appréciable au slogan “l’école de la confiance” qui inaugura le règne du ministre de l’Education nationale du Président Macron.
Rien n’empêchait effectivement Jean-Michel Blanquer de choisir d’accorder a priori sa confiance aux enseignants quant aux modalités que chacun déciderait de mettre en place pour garder autant que possible le contact avec ses élèves et leurs familles, et poursuivre sa mission d’instruction sous la forme qu’il jugerait la plus adaptée aux différentes situations rencontrées.
C’était également une occasion pour chaque parent soudainement confronté à la présence permanente au domicile d’enfants d’âges et de personnalités parfois très différents, de s’interroger sur les connaissances et les valeurs qu’il lui semble important de transmettre à chacun, et par là-même de se réapproprier ne serait-ce qu’en partie leur éducation et leur instruction, en s’appuyant sur le quotidien à partager : cuisiner, bricoler, jardiner, observer, lire, raconter, chanter, écrire, discuter, dessiner, peindre, etc.
Ces apprentissages contextuels pouvaient au moment de la réouverture des établissements être mis en commun au sein des classes, pour favoriser et enrichir le dialogue entre élèves, sous l’encadrement de l’enseignant. À partir du collège et surtout au lycée, le confinement était propice à l’apprentissage du travail en autonomie, appuyé sur les manuels scolaires, en version papier ou numérique pour les élèves inscrits dans un établissement déjà passé au 4.0.
Cette expérience grandeur nature aurait d’ailleurs pu être mise à profit pour étudier objectivement les apports respectifs des deux types de supports et décider ensuite sur des bases pédagogiques sérieuses de l’opportunité de poursuivre ou d’interrompre le basculement en cours vers le tout numérique.
Mais la confiance accordée a priori n’est pas l’option qui été retenue par le Ministère de l’Éducation nationale. Sous couvert de “continuité pédagogique”, il a au contraire choisi de resserrer de facto drastiquement l’étau numérique exercé sur les familles et sur le corps enseignant dépendant de la rue de Grenelle.
C’est ainsi, qu’alors que chacun prenait amèrement conscience des risques créés par une dépendance massive imprudemment consentie, le ministère engageait fermement ses troupes sur la voie d’un recours toujours plus important aux plateformes en ligne, au détriment des manuels scolaires classiques qui ont pourtant fait leurs preuves sur plusieurs générations d’élèves, dont le contenu a notamment le mérite appréciable de rester accessible hors alimentation électrique ou connexion internet, et qui demeurent au moins pour l’instant à l’abri de la boulimie des GAFAM et BATX.
Balisée par la proposition de loi n°2967 de la députée Frédérique Meunier, la voie de l’enseignement distanciel connecté est donc clairement privilégiée en haut lieu, sans véritable consultation des principaux intéressés, et sans prise en compte des voix de plus en plus nombreuses qui s’élèvent en opposition à la numérisation galopante du système éducatif, tant du côté des parents d’élèves et des professeurs des académies concernées que des professionnels de santé.
Assurément, la leçon à tirer du manque de masques n’a pas été retenue par ceux qui entendent renforcer toujours davantage la dépendance des élèves, il est vrai futurs consommateurs, aux nouvelles technologies et aux infrastructures matérielles lourdes sur lesquelles elles s’appuient.
Si elle s’est amplifiée ces dernières années, et a connu une notable accélération grâce au Covid-19, la tendance n’est certes pas nouvelle. Depuis le « Plan Calcul » de 1966, les plans numériques visant l’enseignement se sont en effet succédé en France à un rythme soutenu. Il s’agissait à l’origine de former les élèves qui le souhaitaient à l’informatique, nouvelle science source de nombreux fantasmes.
Mais en même temps que les ordinateurs, puis les tablettes et les smartphones ont envahi notre quotidien, les objectifs affichés se sont étendus dans des proportions si larges qu’il devient difficile d’y voir clair. À en croire les promoteurs actifs des EdTech, dont le ministère de l’Éducation nationale s’avère généralement un représentant zélé, il s’agirait aujourd’hui de « faire entrer l’école dans le XXIᵉ siècle », de permettre aux nouvelles générations de « maîtriser leur environnement futur », présupposé massivement numérique, ou encore « d’assurer la réussite de tous les élèves » à l’heure de l’école inclusive.
Mais de quelle école inclusive parle-t-on ? D’une école où le nombre de professeurs est suffisant pour permettre l’accompagnement de chacun selon ses besoins ou d’une école où chaque élève en difficulté est installé devant un logiciel spécialisé ? Prenons garde à la perte de sens, subie ou sciemment organisée par une société du spectacle notamment dénoncée par Guy Debord et dans laquelle nous nous embourbons chaque jour davantage… On nous vend aujourd’hui que, grâce à l’Intelligence Artificielle, les enseignements seront « personnalisés au plus près des besoins de chacun ».
L’oxymore prêterait à rire si les objectifs qu’il dissimule n’étaient pas si sérieux. Comment peut-on oser employer le terme de personnalisation alors que, du fait même qu’il s’agit de remplacer la relation directe entre deux êtres humains, l’élève et son professeur, par l’interaction entre un être humain et l’interface autorisée d’une machinerie opaque, le terme de déshumanisation serait infiniment plus légitime ?
Les technologies numériques exercent une fascination qui n’est qu’une conséquence logique du rôle donné aux sciences appliquées dans le monde contemporain. Il suffit au tableau noir et vieillot de se remplir d’électronique et de logiciels et de s’offrir une connexion à Internet, pour accéder au statut prestigieux « d’outil numérique connecté interactif ». Rappelons tout de même qu’aujourd’hui, tout peut être connecté, y compris les maillots de bain et les bigoudis (comme s’en félicitait peu de temps avant le confinement, dans les Dernières Nouvelles d’Alsace, le président de la région Grand-Est, Jean Rottner, en visite au CFA de Mulhouse).
Depuis Descartes, le culte de la science constructive et de tout ce qui se pare de ses vertus n’a cessé de s’étendre toujours davantage en Occident, et de là, a gagné la quasi-totalité du globe. De l’observation et de la recherche de sens, nous sommes passés à la modélisation et à la recherche d’efficacité. Le modèle conceptuel, support de l’analyse et de la réflexion permettant d’appréhender certains aspects du réel infiniment complexe, est aujourd’hui devenu la vérité, l’oracle absolu, l’objectif en soi.
Lorsque la pensée est vue comme un réseau de neurones, l’algorithme peut sembler le summum de la réflexion humaine. Quelle tristesse, quel appauvrissement !… Il est évidemment faux de prétendre qu’en apprenant la programmation aux élèves et en les plongeant dans un environnement tout numérique quasi-permanent on leur en assure la maîtrise future. Sauf à considérer que les oies gavées maîtrisent le maïs, ce qui ne fait pas encore consensus…
La situation que nous venons de vivre à l’échelle mondiale nous montre si besoin était que nul ne peut aujourd’hui prétendre décrire avec certitude ce à quoi ressemblera notre société dans les années – a fortiori les décennies – à venir. Les oracles qui assurent que « 65% des métiers qui seront exercés par les élèves actuels n’existent pas encore » relèvent dans le meilleur des cas de l’hypothèse gratuite, dans le pire des cas de malversation intellectuelle intéressée.
Au rythme où vont les choses, une société future de sobriété généralisée n’est pas plus improbable que la société massivement numérique qu’on nous promet et que certains investisseurs ou certains individus à tendance mégalomaniaque prononcée appellent de leurs vœux plus ou moins discrets. Le meilleur service que nous puissions rendre à notre jeunesse de ce point de vue n’est certainement pas de la confronter dès l’école primaire à des interfaces de logiciels spécialisés aussi ludiques soient-elles, ni de l’habituer au collège à l’utilisation d’un moteur de recherche, d’un traitement de texte, d’un tableur, d’un logiciel de géométrie dynamique ou d’un réseau social quels qu’ils soient, ni même de lui enseigner la programmation, connectée ou non.
Même si certains de ces outils peuvent présenter une utilité ponctuelle, tous ont en commun de priver l’élève d’une interaction physique directe avec son environnement réel, et de brider d’une manière ou d’une autre ses espaces de liberté sans toujours l’expliciter. Le meilleur service que nous puissions rendre à notre jeunesse est en revanche de préserver et d’enrichir son capital humain en accordant une place suffisante à l’enseignement approfondi des « humanités » (lettres, histoire, arts et philosophie) face à un enseignement utilitariste à courte vue centré sur quelques compétences technoscientifiques, les méthodes de lecture rapide ou les concours d’éloquence.
Bien avant l’avènement de l’informatique grand-public, donc des outils numériques et d’Internet, George Orwell écrivait en 1945 : « La seule compétence dans une ou plusieurs sciences exactes, même lorsqu’elle est associée à des dons remarquables, n’est d’aucune façon le gage d’une disposition à l’humanité ou à l’esprit critique. Les physiciens d’une demi-douzaine de nations qui travaillent tous fébrilement et en secret sur la bombe atomique en sont la démonstration. Mais tout cela signifie-t-il que le grand public ne devrait pas recevoir une meilleure éducation scientifique ? Bien au contraire ! Cela signifie seulement que l’éducation scientifique des masses fera peu de bien, et probablement beaucoup de mal, si elle se réduit à davantage de physique, de chimie ou de biologie, au détriment de la littérature et de l’histoire. Elle aura probablement pour effet sur l’homme ordinaire de restreindre l’envergure de sa réflexion et d’accroître son mépris pour les connaissances qu’il ne possède pas ; et sans doute ses réactions politiques seront-elles plutôt moins intelligentes que celles d’un paysan illettré qui aura conservé quelques souvenirs historiques et un sens esthétique assez sain. »
Relisons également Jacques Ellul et gardons à l’esprit que la technique n’est pas neutre mais ambivalente : les côtés positifs et négatifs des technologies numériques coexistent quelque usage qu’on en fasse, Intelligence Artificielle incluse. Après avoir été passés sous un long silence stratégique, certains impacts environnementaux, sanitaires et sociaux commencent à être dénoncés et ne peuvent définitivement plus être ignorés.
Parallèlement, le bilan qui se dégage de l’utilisation des ordinateurs, tablettes et smartphones dans le domaine éducatif s’avère non seulement décevant mais inquiétant. En dépit de tous les discours marketing qui continuent à promettre monts et merveilles, et malgré les intérêts financiers en jeu, colossaux, aucune étude sérieuse n’établit à ce jour la supériorité des outils numériques pour les apprentissages ou leur innocuité pour le reste. Des analyses concordantes de plus en plus nombreuses sont en revanche suffisamment préoccupantes pour justifier dès à présent l’application immédiate du principe de précaution élémentaire pour les enfants et les adolescents, a fortiori dans le cadre de l’institution scolaire.
Discours médiatiques et décisions gouvernementales successives de numérisation tous azimuts apparaissent malheureusement comme ayant été biaisés par des intérêts très éloignés de ceux des futures générations. Notre responsabilité d’adultes nous impose à présent d’ouvrir les yeux et de reprendre la main. Il ne s’agit aucunement de refuser a priori tout dispositif numérique, mais de prendre le temps de distinguer les apports réels des apports fantasmés en questionnant chacun de nos usages, et de mettre systématiquement en balance les apports réels, les nuisances et les risques dans leur globalité.
Et, sauf à assumer une « technocrature », il s’agit a minima de permettre à chacun, en son âme et conscience, de refuser le cas échéant ces usages. Sur la question numérique comme pour le reste, l’enseignant, sous réserve qu’il ait bénéficié d’une formation suffisamment solide, est évidemment le plus à même de connaître en toutes circonstances les besoins réels de ses élèves, et par là de choisir les outils et les méthodes adaptés au meilleur exercice de sa mission éducative.
Une complète liberté pédagogique, la confiance des parents et des effectifs de classe limités sont nécessaires pour lui permettre d’exercer son travail dans les conditions requises par l’intérêt de l’enfant ou de l’adolescent. La crise que le pays vient de traverser a mis une fois de plus en lumière combien ce cadre pourtant indispensable était sérieusement malmené à tous les niveaux au sein de l’Education nationale. Les écoles indépendantes sont la soupape qui permet au système de respirer en proposant aux professeurs, aux parents et aux élèves des modèles alternatifs inspirants à taille humaine. Sachons préserver et utiliser au mieux cette liberté, pour tous les enfants.
Souhaitons, enfin, que les futurs « États généraux du numérique pour l’Education », annoncés en juin par Jean-Michel Blanquer, qui se tiendront à Poitiers les 4 et 5 novembre 2020, sauront faire la place à une vision raisonnée du sujet et remettre le numérique à sa place, loin des préoccupations mercantiles qui écartent le temps long pourtant nécessaire à la bonne appréhension des enjeux au cause.
Catherine Lucquiaud
Docteur en informatique
Chargée des questions numérique au sein de la Fondation pour l’école
Tribune parue en Juillet 2020 dans la revue Liberté Politique,
que nous remercions pour son aimable autorisation de reproduction.
Lire l’épisode 1.
Partager sur :
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp