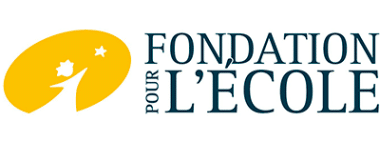« Puisque c’est impossible, faisons-le ». Un titre qui résonne comme un défi. Un livre qui ressemble à son auteur, Charles Beigbeder, créateur d’entreprises, homme d’affaires, secrétaire national de l’UMP à la pédagogie de la réforme. Donner un rôle moteur à l’éducation signifie pour lui en revenir à un pragmatisme détaché des utopies, donner plus de pouvoir et de libertés aux acteurs de l’éducation – parents, enseignants, directeurs –, enfin, promouvoir le mérite. Il répond ici à nos questions.
« Puisque c’est impossible, faisons-le ». Un titre qui résonne comme un défi. Un livre qui ressemble à son auteur, Charles Beigbeder, créateur d’entreprises, homme d’affaires, secrétaire national de l’UMP à la pédagogie de la réforme. Donner un rôle moteur à l’éducation signifie pour lui en revenir à un pragmatisme détaché des utopies, donner plus de pouvoir et de libertés aux acteurs de l’éducation – parents, enseignants, directeurs –, enfin, promouvoir le mérite. Il répond ici à nos questions.
Qu’est-ce qui vous a poussé à consacrer plusieurs chapitres à l’éducation que vous qualifiez de « chantier fondateur, celui qui donnera leur raison d’être à tous les autres »?
Comme je l’annonce dans l’introduction de cet ouvrage, il ne s’agit pas d’un énième livre relatif au déclin de la France mais d’un recueil de solutions simples et pragmatiques. Il est vrai que dans le constat que j’ai dressé, j’ai donné un rôle moteur à l’éducation. Je tire cette conclusion de mon expérience d’entrepreneur autant que de mon parcours personnel.
L’éducation, ce n’est pas seulement donner un ensemble de connaissances théoriques ou pratiques à des élèves mais c’est aussi fournir aux générations futures un cadre dans lequel elles évolueront et formeront les citoyens, les entrepreneurs, les décideurs de demain. Les graves lacunes dont souffrent les Français en matière de compréhension de l’économie, et qui ont un impact important en termes de pédagogie et de faisabilité des réformes, trouvent leur origine dans l’éducation. De même, l’incompréhension du fonctionnement de l’Union européenne, y compris parmi nos étudiants impliqués dans les études supérieures, participe de son déficit de légitimité.
Comme les effets d’une telle réforme, et je reviendrai sur l’ampleur que cela implique, ne seront pas immédiats, il est nécessaire d’ouvrir ce chantier avant tous les autres, pour que les bénéfices de l’innovation, de l’autonomie, de la confiance, de la méritocratie irriguent à nouveau tous les autres pans de l’action publique.
Vous réclamez vigoureusement que l’école en revienne au « seul vrai programme qui vaille dans le primaire, c’est lire, écrire et compter. Tout le reste est superfétatoire si ces trois objectifs ne sont pas atteints ». Pensez-vous l’Éducation nationale capable d’un tel sens des réalités et des urgences, alors qu’elle développe avec délectation depuis des décennies toutes sortes de complications absconses à rebours de ce programme ?
Je dirai que l’Éducation nationale est victime du syndrome de « l’État nurserie ». Parce que l’accès à la culture n’est pas également assuré à travers les familles, il faut le démocratiser via des programmes artistiques ; parce que certains élèves sont en surpoids, il faut veiller à leur faire pratiquer une activité physique régulière et ainsi de suite. Malheureusement, ces strates de matières accessoires ont fini par réduire l’essentiel à peu de chose.
Dans le même temps, l’utopie égalitariste a voulu sacrifier des méthodes d’enseignement ayant fait leurs preuves, telle que la méthode syllabique, en instaurant de nouvelles façons d’apprendre qui, sous couvert d’égalité, empêchent l’accès à la lecture. Et c’est ainsi que pour un volume d’heures par élève parmi les plus élevés de l’OCDE, les performances des Français dans les tests internationaux (PISA) ne cessent de se dégrader.
L’Éducation nationale, comme toute organisation sociale complexe, se pense imperméable au changement. Elle ne perçoit le changement que de manière incrémental. Comme le paquebot qu’il est difficile de faire changer de cap brusquement, ses dirigeants et ses membres ont tendance à être victimes de la “dépendance au sentier” (path dependency en anglais), c’est-à-dire la fuite en avant dans l’erreur pour éviter de la reconnaître. Il est donc fortement improbable que le changement vienne de l’intérieur, surtout que le système est tellement fort qu’il est capable de neutraliser de lui-même les éléments qu’il considérerait comme subversifs. Le changement ne pourra donc être qu’exogène.
Vous criez « haro » sur le collège unique. Comment sortir de cette impasse ?
Avant toute chose, le collège unique trouve son origine dans la loi Haby de 1975, il n’est donc pas une règle d’airain. Les Français ont d’ailleurs bien compris que le modèle du collège unique avait atteint ses limites. D’après un sondage CSA paru en avril 2011, 67% des Français estiment qu’il faut abandonner ce modèle et 81% qu’il faut créer des parcours plus individualisés pour les élèves.
Il ne s’agit pas de mettre fin au collège unique d’un coup de baguette magique, il y a un travail de réforme progressive à mener. Il faut d’abord élargir les parcours proposés aux élèves puis donner aux chefs d’établissements plus de pouvoir dans l’élaboration d’une offre susceptible de remporter l’adhésion des parents et de leurs enfants. Nous pouvons apprécier les évolutions marquées par la circulaire de rentrée 2011/2012 qui prévoit, à titre expérimental, des évaluations à la fin de la classe de cinquième et la possibilité, pour les élèves les plus sûrs de leur choix, de rejoindre des parcours professionnels anticipés.
Cette refonte du collège unique est aussi la meilleure solution aux échecs de l’orientation. Nous avons en France 250.000 à 500.000 postes non pourvus. Ce volant d’emplois, s’il était rempli, correspondrait à une diminution du chômage supérieure à 10%. Parmi les secteurs qui recrutent se trouvent les services à la personne, l’hôtellerie-restauration et le tourisme, le secteur de la vente et l’efficacité énergétique et les énergies nouvelles, autant d’opportunités méconnues qui mériteraient d’être présentées beaucoup plus clairement, avec les voies d’accès afférentes, aux parents comme aux élèves.
Vous qui êtes un capitaine d’industrie, quels conseils donneriez-vous pour améliorer la gouvernance de l’Éducation nationale ?
Comme je vous le disais, la gouvernance de l’Éducation nationale souffre de deux grands maux : la croyance dans l’impossibilité du changement et la dépendance à l’erreur. Il y en a même une troisième, un sentiment d’indépendance et une volonté de s’affranchir de l’autorité de tutelle que représente le ministère.
Or le système scolaire français étant extrêmement concentré et centralisé, le pouvoir est quasi absolutiste. Il apparaît que les commissions chargées de la construction des programmes ont parfois du mal à se départir de certaines idéologies. On l’observe par le biais de la restructuration du programme d’histoire, qui a mis au ban les grands hommes de l’histoire de France, Napoléon Bonaparte et Louis XIV, voire l’idée de nation française. Cela est imprégné d’un principe de précaution intellectuel, visant à garantir un politiquement correct qui menace la fabrique du vivre ensemble que représentait aussi l’école.
Afin d’améliorer cela, il faudrait que les usagers, ou plutôt leurs représentants, à savoir les parents, soient plus impliqués dans l’élaboration des grandes orientations touchant à l’éducation, y compris pour les questions relatives au contenu des programmes.
Vous dénoncez le culte bien français du diplôme. « Le but implicite du secondaire doit cesser d’être le baccalauréat général », affirmez-vous notamment. Pouvez-vous préciser votre vision à ce sujet ?
Le baccalauréat général est victime d’un double mouvement paradoxal : d’un côté, il est sacralisé au point de faire de la divulgation ex ante du sujet de l’épreuve de mathématiques, un événement d’envergure nationale ; de l’autre, les lycéens comme leurs parents ont parfaitement conscience de sa dévalorisation.
Le réel confirme ce ressenti. Une étude de l’INSEE en 2009 pointait du doigt le fait que la rémunération d’un bachelier général était inférieure à celle de certains CAP ou BEP, aujourd’hui au bac professionnel, demandés dans l’industrie. Dans le même temps, l’inflation des mentions traduit cette inévitable dévalorisation du diplôme. Près de la moitié des bacheliers généraux ont décroché une mention en 2010 alors qu’à peine 27% des lauréats en obtenaient une en 1990. Concernant la mention «très bien», la hausse est encore plus impressionnante, de 1% en 1990 à 7% en 2010. D’ailleurs l’étude sur le bac du sénateur UMP Jacques Legendre parue en 2008 pointait du doigt une certaine injustice : il est beaucoup plus facile d’obtenir un bac scientifique avec mention très bien qu’un bac technologique ou professionnel.
Dans ces conditions, le baccalauréat n’a plus de vertu. L’échec est une fatalité qui ferme les horizons professionnels, quand sa réussite n’apporte plus aucune reconnaissance pour son titulaire. A l’instar des systèmes scolaires les plus compétitifs de l’OCDE, qu’ils soient asiatiques, européens ou américains, le secondaire doit se conclure pour les élèves qui souhaitent poursuivre des études supérieures généralistes, par un examen d’entrée à l’université.
Comment pourrait-on libérer l’école de cette idéologie égalitariste qui la condamne à l’échec depuis si longtemps ?
Face à l’égalitarisme qui confine tôt ou tard à l’apathie généralisée, le seul moyen de redonner force à l’école c’est de promouvoir le mérite. La méritocratie est un système d’organisation dans lequel les responsabilités sont assignées aux individus en fonction leur intelligence ou de leurs aptitudes. Il ne s’agit pas de mettre en place un système de compétition sauvage mais de restaurer cette saine émulation qui poussait chacun à se dépasser.
Il faut rappeler que la république voire la nation française s’est construite par et grâce à cette méritocratie. Quel plus bel exemple que nos concours, sans discrimination d’origine, de culture, gratuits, qui permettent à chacun de montrer sa valeur et d’accéder ainsi aux plus hautes responsabilités. Il est remarquable que le concours subsiste au niveau des grandes écoles de notre pays. Néanmoins, quand je vois les mesures prises par certains établissements qui ébranlent les fondements mêmes du concours, je m’inquiète.
L’éducation n’est pas une dépense, c’est un investissement selon vous. Que préconiseriez-vous pour que les familles puissent investir dans le système scolaire de leur choix ?
Il y a quelque mois, le gouvernement anglais a décidé de débloquer une ligne de crédit spéciale d’un montant de 600 millions de livres afin de réaliser la construction de 100 nouvelles écoles libres (free schools) dans le pays dans les trois prochaines années.
Ces écoles libres peuvent être fondées par des groupes de parents, des professeurs, des fondations, des universités, des groupes religieux ou associatifs. Elles sont dirigées par des tiers indépendants du ministère de l’Éducation ou des collectivités locales qui se contentent alors de les financer. Elles ont un pouvoir renforcé sur le choix et la rémunération des enseignants, la constitution des programmes et le calendrier scolaire. Je suis cette initiative avec intérêt et pense même que nous pourrions consacrer une ligne de crédit à l’expérimentation d’un tel programme sur un territoire déterminé.
Je remarque aussi que les Anglais dont on vante si souvent l’enseignement général, en critiquant l’enseignement français qui serait trop spécialisé, expérimenteront, parmi ces 100 écoles, 12 écoles sélectives en mathématiques, pour des élèves âgés de 16 à 18 ans.
Charles Beigbeder, Puisque c’est impossible, faisons-le, JC Lattès, 2012, 225 p.
Partager sur :
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp